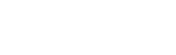Autoritarisme et préjugés dans la police : L’effet d’une position d’infériorité numérique et le rôle du contexte normatif
Résumé
Le constat
La scène publique offre de multiples exemples de l’hostilité directe entre les policiers et les
populations stigmatisées : agression, affrontements (Bui Trong, 2003), comportements
discriminatoires (Commission Nationale de Déontologie, 2005) ; avec une tendance
majoritaire des policiers à avoir un comportement négatif à l’égard de populations
désavantagées, soit à avoir des préjugés intergroupes : un phénomène robuste et récurrent
(Teahan, 1975 ; Body Gendrot & Whitol de Wenden, 2003 ; Carlson & Sulton, 1974). Or
d’après le Code de Déontologie (1986) de la Police Nationale, l’article 7 stipule que : « (…).
Le policier est intègre et impartial (…). Placé au service du public, (…) se comporte envers
celui-ci d'une manière exemplaire. Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur
nationalité ou leurs origines, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses
ou philosophiques. ».
Le dilemme
Le policier a des attitudes intergroupes hostiles non-conformes au Code de déontologie
pouvant activer et/ou agrémenter l’hostilité intergroupe. Nous nous interrogeons donc sur sa
capacité à gérer sa relation au public, ses fonctions et sa tenue « exemplaire ».
L’objectif de nos travaux : est de déterminer pourquoi les policiers ont généralement plus de
préjugés envers les groupes stigmatisés que la population standard. Généralement, ces
groupes stigmatisés sont marginalisés, ont une mauvaise réputation (e.g. les jeunes de
quartiers dits sensibles et les maghrébins). Les facteurs impliqués dans la régulation de ce
phénomène sont nombreux. Nos travaux spécifient le rôle prépondérant de l’environnement
normatif et de l’autoritarisme sur le niveau de préjugés intergroupes des policiers.
L’étude :
Les travaux récents montrent les préjugés persistants chez les policiers à l’encontre des jeunes
des banlieues (Boussard, Loriol, & Caroly, 2005). C’est donc dans une perspective
d’amélioration du système organisationnel de la police que nous proposons une évaluation
circonstanciée des préjugés intergroupes dans la police s’articulant autour de deux points
contextuels très importants : la position numérique des policiers en service actif lors
d’interaction avec le public et, le type de missions policières assignées (préventives ou
répressives) dans le cadre des missions de sécurité publique prescrites par le Ministère de
l’Intérieur. Le premier point discuté concerne les effectifs de police en quartiers dits sensibles
; point discuté aussi parmi les policiers manifestants le 23 octobre 2008 à Paris. Le second
point concerne la « réelle » dichotomisation des missions, soit l’existence de deux
environnements normatifs interchangeables.